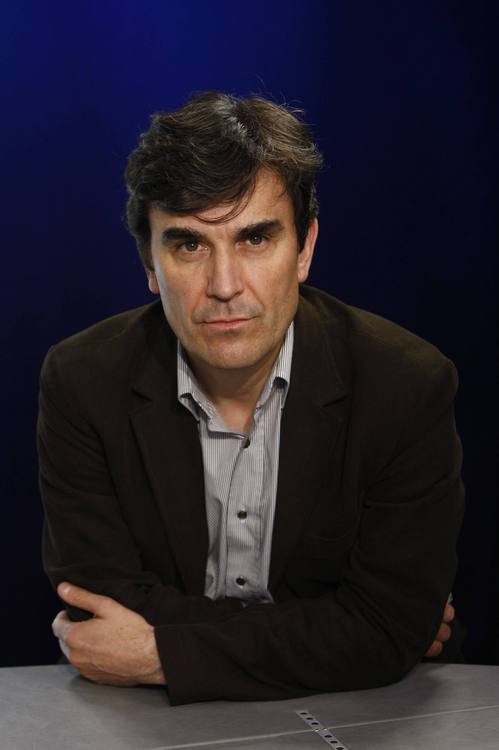Georges Malbrunot est reporter de guerre. Cela fait maintenant 25 ans qu’il sillonne les pays du Proche-Orient, toujours au service de l’information. Malgré un parcours semé d’embuches, dont une prise en otage de quatre mois, ce journaliste ne peut s’empêcher d’exercer son métier.
Aloïs Liponne : Pouvez-vous expliquer votre envie d’être reporter dans les pays du Proche-Orient ? Comment avez-vous vécu votre arrivée là-bas ?
Georges Malbrunot : Je suis sorti diplômé de l’Institut pratique du journalisme en 1986. J’ai d’abord commencé par travailler pour le journal La Croix, sur la politique interne. J’ai été envoyé à Jérusalem en février 1988, pour un reportage, lors de la première intifada. C’était la première fois que je me rendais là-bas.
C’est une fois sur place que j’ai “attrapé le virus”, j’ai eu le coup de foudre pour le reportage de terrain et le monde Arabe. Les dimensions humaine, historique et tragique ont fait que j’ai eu envie de m’intéresser au dossier israélo-palestinien.
Une fois rentré j’ai travaillé pour l’AFP, mais en CDD parce qu’ils n’embauchaient pas à l’époque. Je suis alors retourné dans les pays du Moyen-Orient pour faire des reportages. En 1994, je suis allé m’installer à Jérusalem.
A.L : Cela fait 25 ans que vous parcourez le Monde Arabe et que vous écumez les terres en guerre, comment voyez-vous la guerre dans l’information ?
G.M : Il est indéniable que la guerre est un sujet d’information récurrent là-bas. Cela donne deux facettes à l’information.
Tout d’abord, c’est une information facile à raconter, il y a de la matière. Les témoignages, ce que je peux voir, ce sont des moments forts, qui donne à voir et à raconter. D’ailleurs, je n’ai pas seulement ce que je vois à raconter. Il n’y a pas que le reportage en soi qui est intéressant, il y a toute l’organisation de la guerre, ce qu’il se passe en coulisses. Il faut dresser le tableau dans sa globalité.
En revanche, il faut toujours faire attention. Il n’y a pas des conflits en permanence, mais il faut être prudent. Dans certains pays, comme au Yémen, je me rend là-bas d’ici peu et la situation est vraiment instable. Il n’y a pas de pouvoir politique en place, les forces armées sont sur le territoire. C’est une zone que l’on peut qualifier d’anarchique, il faut d’autant plus être prudent.
La dimension humaine
A.L : C’est difficile pour vous de raconter ce qu’il se passe, d’intéresser le lecteur ?
G.M : L’information est forte. C’est facile de raconter ce qu’il se passe, puisqu’il y a des scènes, des témoignages forts et percutants. Il y a beaucoup de sentiments humains dans ce que je raconte, cela intéresse et interpelle facilement le lecteur. En tout cas, c’est plus simple de raconter ce qu’il se passe quand il y a une dimension humaine, que de faire un article sur le rapport d’une entreprise. Le public est touché, empathique par la facette humaine de la guerre.
A.L : Qu’est-ce que vous pensez de la manière dont le médias en région traitent les conflits ?
G.M : Les médias locaux transmettent un peu des informations sur les conflits. Il n’y a pas seulement les titres de presse nationale qui font de l’information sur les conflits. Pendant 11 ans, j’ai été correspondant pour plusieurs titres de presse quotidienne régionale, tel que Ouest France, La Voix du Nord, La Charente Libre et d’autres.
A.L : Après avoir été enlevé, est-ce que vous voyez toujours votre métier de la même manière ?
G.M : Je travail toujours de la même manière, mes fondamentaux n’ont pas changé. J’ai relativisé un certain nombre de choses. Je vois ce qu’il s’est passé comme un événement extraordinaire, mais qui ne m’a pas démotivé sinon j’aurai changé de métier.
Bien sûr, j’ai pris le temps avant de retourner en Irak, environ cinq ans, parce que je sentais que c’était trop compliqué. Je vais au Yémen dans peu de temps et je vais faire très attention, mais je ne peux pas arrêter de faire mon métier.
A.L : Pour vous, quelle serait la meilleure façon de dire la guerre ?
G.M : Le mieux est toujours de raconter ce que l’on voit, la réalité du terrain. C’est difficile parce qu’en général, l’on est qu’à un endroit précis et il y a du conflit à plusieurs endroits différents dans le pays. Je raconte qu’une infime partie de ce qu’il se passe en réalité et dans la globalité du conflit. Il faut toujours être conscient que l’on raconte seulement les événements d’un endroit à un instant T. Il est aussi primordial de prendre du recul.